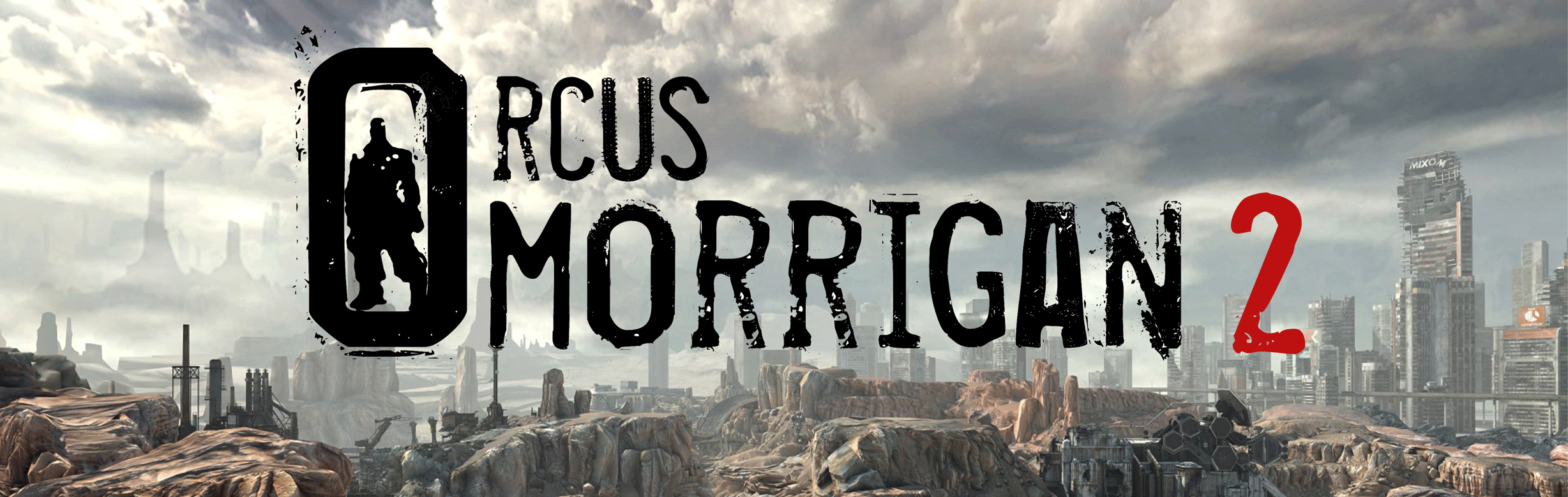Il ouvrit le couvercle et je sortis.
Le couvercle, c’est celui du caisson hermétique, rempli d’un liquide visqueux et régénérant, dans lequel je macère à longueur d’éternité, entre deux missions.
Vu notre condition à nous autres, zombies, on a intérêt à bénéficier de ce genre d’avantages. Parce qu’on pourra toujours critiquer ces chiffes molles de vampires avec leur teint d’endives albinos et leurs verveines à l’hémoglobine, eux au moins ne se décomposent pas dès qu’ils sont à l’air libre, et ne sèment pas de morceaux de bidoche avariée derrière eux, genre Petit Poucet en putréfaction.
Donc, le jus verdâtre duquel je m’extrais est censé ralentir le processus de décomposition quand je ne suis pas au taf. Mon premier réflexe, quand je sors tout dégoulinant de mon court-bouillon, est d’ailleurs de me palper le service trois pièces, vérifier que tout le matos est encore en place, et qu’il n’y ait pas une de mes testiboules qui se soit détachée pendant que je mijotais.
Je m’en voudrais qu’il y ait une couille dans le potage.
Bon, les sœurs Brontë sont encore attachées au mât de misaine, je peux enfin m’intéresser au type qui est venu me libérer de mon caisson.
— Salut Wilson, ça boume ?
— Quand tu auras fini de jouer tes coquettes, tu pourras t’habiller, qu’on puisse enfin discuter boulot ?
Lui, c’est Wilson. Enfin, Wilson… C’est ainsi qu’il s’est présenté à moi, le jour où il a ramené ma dépouille à la « vie ». Tel que je le vois, il mesure plus de deux mètres, est chauve comme une boule de bowling, doit peser dans les 180 kg, porte un futal fuchsia, une veste blanche, un gilet moutarde, une lavallière et une canne à pommeau.
Bref, la grosse gonfle sortie tout droit d’un night-club des années 70.
En réalité, il s’appelle Wilson comme moi Clitorine, et il a autant l’air de ce Bibendum sous acides que moi d’une bonne sœur.
Pour faire simple, Wilson, c’est la représentation du Mal. Selon les civilisations et les époques, on l’appelle Satan, Moloch, Sekhmet, Loki ou Castaner.
C’est bon, vous avez pigé ?
Wilson, c’est le Diable, et c’est mon patron.
Je me dirige, tout visqueux, vers mon casier, dont je sors ma tenue de prédilection : chaussures de sécurité, pantalon treillis, sweat à capuche et bombers.
— Je suis prêt, boss.
— Suis-moi.
« Suivre » Wilson consiste à passer à travers le portail temporel qui s’ouvre aussitôt devant lui. Nous débouchons alors dans son bureau. Chaque fois que j’y pénètre, je m’interroge. À première vue, il s’agit d’une pièce hyper moderne, mélange de bois luxueux, d’acier et de verre, au dernier sommet d’une tour gigantesque. Dehors, il fait toujours nuit, et de ses vitres immenses, Wilson bénéficie d’une vue incomparable sur les lumières de la ville. Oui mais de quelle ville s’agit-il ? J’ai beau contempler le paysage dès que je peux, on pourrait aussi bien se trouver à New York, Dubaï, San Francisco, Londres ou Choisy-le-Roi, impossible de reconnaître.
— Pas trop rouillé ? me demande Wilson.
Je le soupçonne de se foutre un tantinet de ma gueule, avec cette expression. N’oublions pas en effet qu’il ne me reste qu’un bras d’origine, l’autre étant passé à la broyeuse à végétaux lors d’une précédente mission, et ayant été remplacé par un bras métallique de toute beauté, crée sur mesure par le zombie de Léonard de Vinci.
— Ha ha. Très drôle. Non, je suis en pleine forme. Ça fait combien de temps depuis la dernière mission ?
— Bientôt six ans.
Six ans ? Ma mâchoire manque, littéralement, de se décrocher. Il faut dire que lorsque je suis dans mon caisson, le liquide dans lequel je suis immergé s’apparente à du sirop d’oubli. J’y flotte dans un état de conscience minimale, comme dans une douce léthargie, sans aucune notion du temps qui passe ni de ma condition d’âme errante.
— Ben il faut croire que tes autres lieutenants te donnaient pleine satisfaction, je réponds, un tantinet vexé.
— Ne joue pas les offusqués, Orcus. Il a d’abord fallu que je m’occupe d’une éditrice récalcitrante pour pouvoir te ressortir de ton caisson sans crainte.
— Nathalie C. ?
— Elle-même. Mais rassure-toi, elle est en premier sur ma liste d’admission, et elle n’a pas fini d’en chier quand je l’accueillerai dans mon royaume… Quoi qu’il en soit, je peux à nouveau te lancer sur le terrain.
Un rictus étire ma joue putréfiée, libérant quelques asticots qui tombent sur la moquette en se tortillant.
— Ça tombe bien, j’ai une dalle, tu n’as pas idée. J’ai envie de tripes, là. Des encore fumantes, bien visqueuses et qui sentent la merde. Je dois éventrer qui ?
Wilson s’approche d’une porte que je n’avais jamais remarquée jusqu’ici.
— Avant de t’expliquer quelle sera ta prochaine cible, il faut que je te présente quelqu’un.
— Un autre zombie ?
— Non. Mais approche.
Si j’avais encore des sourcils, je les froncerais. À part d’autres morts-vivants avec lesquels j’ai parfois dû faire équipe, Wilson ne m’a jamais présenté quiconque.
Je le rejoins et il ouvre la porte.
Des volutes de fumée nous accueillent. La force de l’odorat des zombies n’étant plus à prouver, j’en identifie tout de suite l’origine : de la jamaïcaine. Et de la bonne.
Avachi dans un canapé, un énorme rasta black nous attend. Il porte un bonnet à grosses mailles duquel s’échappent des dreads poisseuses, des lunettes de soleil, bien qu’il fasse nuit et qu’on soit dans une pièce sans fenêtre, un bouc poivre et sel, et un tee-shirt informe sur un gros bide de buveur de bière, et sur lequel on peut encore lire l’inscription FUCK ME I’M FAMOUS.
Sur la table basse devant lui, un bong, des briquets, et toute une gamme de plantes de la famille des Cannabaceae riches en tétrahydrocannabinol.
Bref, un bon gros fumeur de oinjs qui, vu l’épaisseur du nuage qui nous accueille, a déjà dû inhaler la moitié de la production des Pays-Bas.
En nous voyant entrer, il affiche un sourire banane et s’exclame :
— Hey ! Le fameux Orcus Morrigan ! Content de faire ta connaissance, man ! T’es une vraie légende, tu sais ?
Je me tourne vers Wilson.
— Tu m’expliques ? C’est qui, ce clown ?
— Tu ne l’as pas reconnu ? s’étonne mon boss.
— Non, pourquoi, je devrais ?
— Ah oui, c’est vrai, toujours cette question d’anthropomorphisme… Orcus, laisse-moi te présenter…