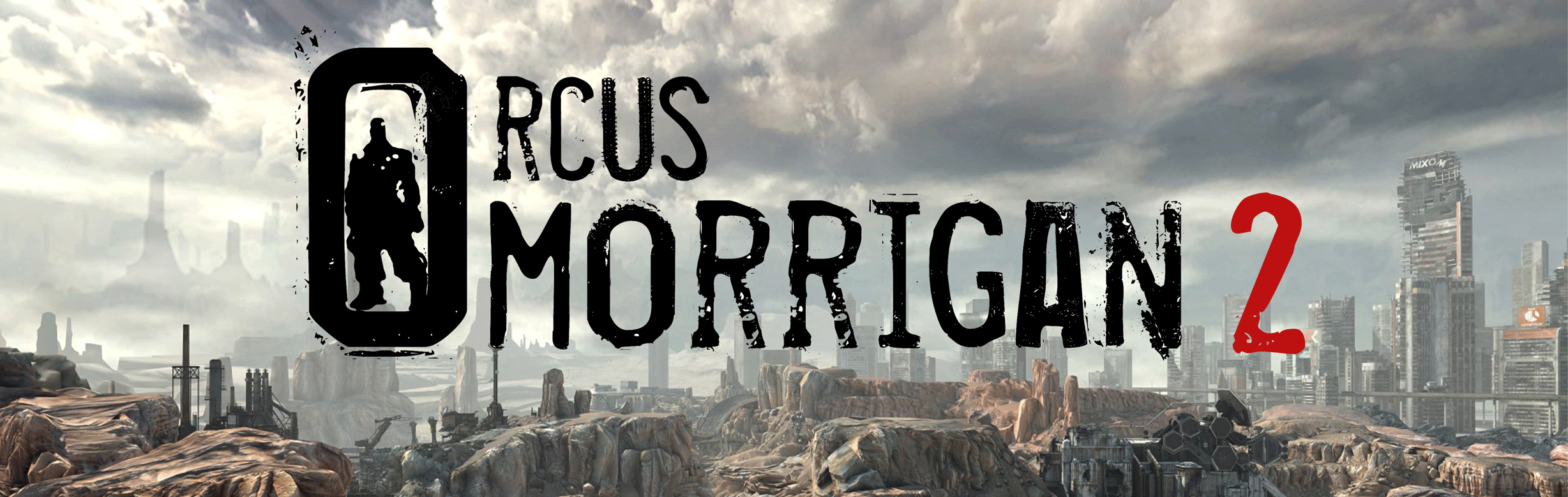— Et moi je suis ébaubi, Tokū.
Mon yellow pote est tellement estomaqué par le spectacle macabre qu’il ne relève même pas la vanne.
Imaginez-vous, au détour d’un sentier, des charognes infâmes, les jambes en l’air, comme des femmes lubriques, brûlantes et suant les poisons, ouvrant d’une façon nonchalante et cynique leurs ventres pleins d’exhalaisons.
Je sens Tokū qui, tout à trac, tique à mes côtés. Mais je n’en ai cure et poursuis ma description lyrique.
Les mouches bourdonnent sur ces ventres putrides, d’où sortent de noirs bataillons de larves, qui coulent comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descend, monte comme une vague ou s’élance en pétillant. On dirait que les corps, enflés d’un souffle vague, vivent en se multipliant.
— Orcus, tu es sûr que ça va ? Tu commences à m’inquiéter, là. Tu as de la fièvre ?
— Regarde comme c’est beau, murmuré-je à Tokū sans quitter des yeux cet hypnotique tableau. Comme ce monde rend une étrange musique, comme l’eau courante et le vent, ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique agite et tourne dans son van.
Une mandale d’une vigueur insoupçonnée m’arrive en pleine tronche et m’arrache à ma contemplation.
— Oh, Tokū, mais ça va pas ? Tu veux que je te décolle la tête, moi aussi ?
Tokū se frotte la main, satisfait.
— Excuse-moi, mais t’étais parti dans des considérations poético-existentielles, sérieux ! Très chouettes, hein, je dis pas, mais on n’est pas là pour faire du symbolisme, mon pote ! On a une mission à mener, et chaque minute qui passe risque de nous faire rater le coche.
— Mouais, que je réponds en me frottant la joue. Mais avise-toi de lever à nouveau la main sur moi, et je te promets que je me ferai un petit jaune cul sec, et sans glace.
Indifférent à mes menaces, Tokū indique le tas de macchabées en train de pourrir en bas du talus.
— Il y en a combien, à ton avis ?
Je regarde les lasagnes de corps en putréfaction. C’est comme quand il y a trop de béchamel : difficile de savoir combien il y a de couches.
— Autant aller voir, décidé-je en descendant le remblai.
Arrivés près du millefeuille de charognes, Tokū et moi commençons par détacher les corps. Tâche ardue car sous l’effet de la chaleur et de la décomposition, ils ont commencé à s’amalgamer. C’est spongieux, ça colle, ça se détache en faisant « splotch », ça se démembre tout seul comme des cuisses de poulet ayant mijoté trop longtemps.
Et puis surtout, ça donne faim, merde ! Parce que plonger les mains dans autant de cadavres avariés, c’est comme si j’étais face à un buffet à volonté. Même quand tu es rassasié, il faut que tu en reprennes encore un peu, que tu en seras malade toute la nuit, à borborygmer et à flatuler en rafale, mais au moins tu auras goûté à tout.
Oh, de la salade de poumon, chouette ! Et là, hum, un tartare de cervelle, je n’en ai pas mangé depuis tellement longtemps. Et cette farandole d’intestins confits à la merde, dis, elle n’est pas gouleyante sur la langue, peut-être ? Ah là là, je ne sais pas si je vais avoir la place pour mâchouiller quelques globes oculaires en dessert.
Mais foin de ces considérations gastronomiques. Tokū et moi achevons de patauger dans ce magma de corps putréfiés et réussissons à reconstituer une dizaine d’individus, abstraction faite des quelques morceaux que nous avons boulotés au passage.
Nous contemplons l’alignement des faisandés, et un triple constat s’impose.
Premièrement, mais ce n’est pas une surprise, tous les défuntés sont Chinois. Je me tourne vers Tokū qui valide mon analyse : pas Japonais ou Cambodgiens ou que sais-je, non, Chinois. Sans trop m’avancer, je suppose donc qu’il s’agit d’habitants de la région.
Ensuite, plus intéressant, les dix gonzes portaient tous des blouses, type laborantins. Bien sûr, elles sont déchiquetées et maculées de sang et d’humeurs diverses, mais pas besoin d’être Sherlock Holmes pour deviner qu’il s’agit du même habit pour chacun des corps. Donc on progresse : dix victimes autochtones, travaillant dans un même laboratoire ou dans une même officine.
Le dernier constat m’alarme davantage. Par acquit de conscience, je m’agenouille près de la charogne la plus proche et passe les doigts dans la plaie qui lui ouvre le ventre dans le sens de la longueur, remonte le long des chairs déchiquetées, et plonge la main dans la cage thoracique, là où aurait dû se trouver le cœur.
Mais de palpitant, point.
— Tu penses à ce que je pense ? demande Tokū.
— Je le crains, oui.
On n’a pas simplement tué ces dix pékins (oui, bon, d’accord, fallait bien que je la fasse, celle-là). Non, on les a massacrés, éventrés, égorgés, trépanés, émasculés, avec une sauvagerie atroce. Mais là n’est pas le pire. Le pire, c’est qu’on les a en partie bouffés.
Les plaies béantes, aux contours déchiquetés, les organes manquants, les membres arrachés et mis en lambeaux portent tous la même signature.
— Des golgoths, soufflé-je.
Pour rappel, il existe deux catégories de zombies : les zombies intelligents, comme Tokū et moi, à qui Wilson confie ses missions. Des lieutenants machiavéliques œuvrant selon des stratégies et des plans mûrement réfléchis.
Et à côté, les golgoths. Les golgoths ce sont les zombies décérébrés, ceux qu’on voit dans les films ou les séries, qui avancent comme des glands à découvert, et n’ont qu’une seule obsession : manger cerveau. C’est de la chair à canon, de la poudre aux yeux que Wilson met au premier plan pour faire diversion, afin de permettre aux zombies comme ma pomme d’agir dans l’ombre en toute discrétion.
Et il ne fait aucun doute que ce charnier à ciel ouvert est l’œuvre d’un ou plusieurs golgoths. Ce qui veut dire…
— … qu’on n’est pas les seuls zombies sur le coup, conclut Tokū. Mince, Wilson est encore en train d’essayer de nous doubler ?
Ce ne serait pas la première fois en effet que notre boss, qui n’aime rien tant qu’à tromper son ennui éternel, s’amuserait à nous mettre des bâtons dans les roues, juste pour le plaisir de nous voir essayer de nous dépatouiller de ses manigances à la mords-moi le chibre.
Pourtant, je le revois avec l’autre grosse gonfle de Yahvé, et je les imagine mal tenter de nous manipuler sur ce coup-là. Ils ont vraiment besoin de nous avec cette histoire de virus tueur.
— Je ne pense pas. Mais un golgoth ne se balade jamais tout seul dans la nature, il est forcément lié à un maître. Et je n’aime pas ça du tout, ça sent le traquenard. Il faut absolument qu’on le retrouve, mais je ne sais par où chercher.
Tokū s’est agenouillé et a ramassé un drôle de truc. Bizarrement, la première image qui me vient est celle d’un médiator. Du temps où je gratouillais ma vieille guitare.
— Qu’est-ce que c’est ?
Tokū me regarde, les yeux brillants.
— C’est une écaille, Orcus. Et devine de quel animal ?
La lumière s’allume soudain.
— De pangolin ?
— Tout juste, Auguste ! Et regarde, il y en a d’autres, à intervalles réguliers.
Mais c’est pourtant vrai. En observant attentivement, on repère une écaille tous les cinq mètres environ. Un couillon de pangolin a semé derrière lui de quoi le retrouver.
— Suivons ces écailles, décidé-je. On n’a rien à perdre de toute façon. Quitte à retrouver un pangolin à la con, autant que c’en soit un qui était à proximité de ce carnage.
Je m’engage aussitôt dans un sentier, les yeux rivés au sol, à la recherche des écailles GPS.
— C’est farce, s’esclaffe mon pote sur mes talons. On est en train de revisiter le Petit Poucet, avec des écailles de pangolin à la place des miettes de pain.
Puis très sérieux, il ajoute :
— Remarque, ça ne me déplairait pas de tomber sur ce petit merdeux avec ses frangins. De manipuler tous ces corps, là, ça m’a donné une de ces dalles. Et je ne serais pas contre me taper ce nabot en guise de quatre-heures.
L’évocation de viande fraîche doit lui stimuler les glandes salivaires, car le voici parti dans des considérations culinaires dignes de Curnonsky.
— Un enfant, c’est bien connu, ça se mange surtout sans cuisson. La chair est tellement tendre et goûteuse que la faire trop cuire ou bouillir serait un sacrilège, et lui ôterait toute saveur. Non, moi, tu vois, le môme, je le débiterais en carpaccio, en commençant par les fesses et les cuisses, avec juste une petite marinade gingembre citron vert. Et toi, Orcus, tu le boufferais comment, le mioche ?
Vous savez qu’il commence à me soûler, le Joël Robuchon d’outre-tombe ?
— Avec du wasabi, Tokū !